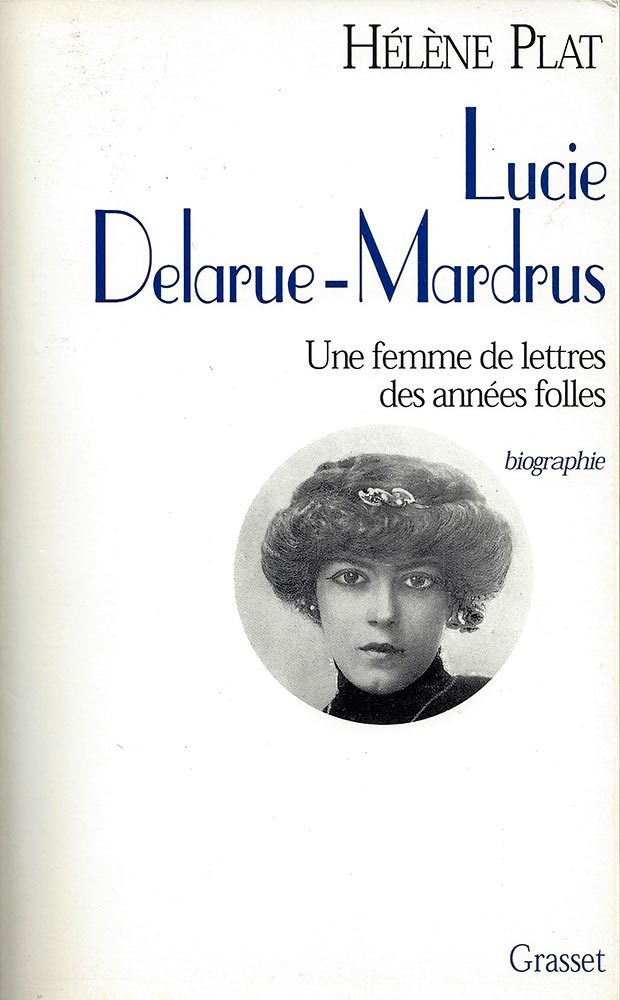Lucie Delarue-Mardrus
Hélène Plat
Grasset
Lucie Delarue-Mardrus (1874-1945) est née à Honfleur dans une famille bourgeoise. Son père, avocat, entretient une nombreuse progéniture… féminine. Elles ne sont pas moins de six sœurs : Alice, Marguerite, Suzanne, Georgina et Lucie est la petite dernière. Sa Normandie natale et son enfance heureuse seront souvent le cadre de ses romans. Elle reçoit une éducation classique, apprend l’anglais auprès d’une gouvernante, fait du cheval, joue du piano, bref tout ce qu’une jeune fille riche de la fin du 19e siècle doit savoir. En 1880, la famille s’installe à Saint-Germain-en-Laye dans un ancien pavillon de chasse situé dans un grand parc dessiné par Le Nôtre. Monsieur Delarue dispose aussi d’un appartement à Paris pour son travail. Laissées aux bons soins de leur mère, les filles vivent une jeunesse joyeuse, comme dans les romans de la Comtesse de Ségur. Si elles suivent aussi une formation religieuse, c’est sans pression et Lucie ne sera jamais croyante.
Les parents les sortent et les emmènent au spectacle. Lucie découvre le théâtre et, grâce à l’entregent de son père, elle fait la connaissance de Sarah Benrhardt qui complimente sa beauté. Elle entretiendra une correspondance avec elle. Adolescente, elle songe à l’amour et commence à écrire des poèmes. Le premier baiser d’un garçon la déçoit totalement. Mais une jeune fille, amie d’une de ses sœurs, l’embrasse sur les lèvres un soir d’été dans un bois et c’est l’émerveillement. La voilà passionnément amoureuse : « Tremblante, enflammée, et, cette fois, toute pareille à mes rêves, j’aurais donné, oui, ma vie, pour un second baiser… » Mais elle n’est pas payée de retour. Ce second baiser ne viendra jamais et Lucie connaît son premier chagrin d’amour.
Elle commence à fréquenter les salons littéraires et en 1896 elle rencontre Marguerite Durand qui vient de fonder La Fronde, quotidien féminin. Elle cherche justement de jeunes collaboratrices et publie les premiers articles de Lucie sur la poésie. Mais rapidement, celle-ci prend conscience que ce journal est bien trop révolutionnaire pour elle. On y défend des valeurs féministes et La Fronde prend parti pour Dreyfus alors que dans la famille Delarue on est violemment anti-dreyfusard. Les filles ayant été élevées dans le respect, voire « le culte » du père, Lucie cesse bientôt sa collaboration à La Fronde.
Il est temps de songer au mariage. Le jeune Philippe Pétain se met sur les rangs, mais la famille repousse cette union (le même s’était vu refuser la main de Séverine). Finalement c’est le médecin orientaliste d’origine égyptienne, Joseph-Charles Mardrus, rencontré lors d’une soirée littéraire qui enlève sa main. Issu d’une famille riche, il a déjà beaucoup voyagé et a publié une adaptation des Mille et une nuits qui l’a rendu célèbre. Catholique, il est féru de poésie et tombe en extase devant les écrits de Lucie. Le mariage a lieu en 1900. Il va tout faire pour qu’elle connaisse le succès. Il l’introduit dans le milieu littéraire, lui trouve un éditeur. Personnage renommé de son époque, Mardrus connu pour son caractère passionné et extraverti a ses entrées partout. La beauté de la jeune madame Mardrus, que son mari appelle « la Princesse Amande » est universellement reconnue. Elle lit ses poèmes chez Robert de Montesquiou qui la pousse sur le devant de la scène.
Le couple voyage énormément, en particulier au Moyen-Orient où il est reçu avec faste. En quelques mois, Lucie parle couramment l’arabe et elle est fascinée par cette civilisation. Elle rédige et vend de nombreux reportages à divers journaux parisiens. Puis c’est le retour en France. Lucie commence à écrire des romans qui connaissent plus de succès que ses poésies. Malheureusement pour elle est partout seconde : en poésie derrière Anna de Noailles et en littérature derrière Colette.
Elle fait la connaissance d’Eva Palme, de Renée Vivien et de Natalie Barney, trois figures emblématiques du monde saphique. Lucie n’a jamais oublié son baiser avec une amie et bientôt, elle entre avec passion dans le monde des amours lesbiennes qui correspond à sa nature profonde. Certes elle aime son mari, l’aimera jusqu’à la fin de sa vie même après leur séparation après quinze de mariage. Grand seigneur, il continuera longtemps à la soutenir et à l’aider. Mais ce sont les femmes qui attirent Lucie.
Elle s’est fait un nom en littérature : elle signe « Delarue-Mardrus » et peut désormais vivre de sa plume et assouvir ses passions. Habituée à un grand train de vie, elle déménage souvent, achète et revend des propriétés à la campagne et entretient des relations amoureuses tumultueuses avec plusieurs femmes.
Elle produit énormément et s’éparpille : poésie, théâtre, romans, conférences, mais aussi peinture, sculpture, spectacle (elle fera même un numéro d’écuyère).
Les années passent, le succès commence à s’estomper. Ses romans se vendent moins, on critique la facilité de son écriture. Elle-même n’aime pas ce qu’elle produit et son activité d’auteure devient principalement alimentaire. Lucie reste très conservatrice dans un monde qui change. Elle est profondément antiféministe et contre le droit de vote des femmes : « Si les femmes obtiennent le droit de vote, l’égalité, etc., elles échangeront un royaume contre un département » déclare-t-elle. Elle fait l’apologie de l’armée en 1926 (les Français se battent au Maroc et en Syrie) et encourage des dons « à la gloire de nos troupes ». Ce qui lui vaut de se faire dézinguer par l’Humanité qui titre : « Pour nos petits soldats, l’aumône des bourgeois et les vers d’une cabotine ». Hélas, s’ensuit un article franchement grossier qui parle de « femmes décolletées jusqu’au cul » et de « putasserie littéraire » signé Parhanine. Une diatribe qui fiche en l’air cette critique pourtant recevable. Elle demandera un droit de réponse. En 1936 elle critique l’arrivée de trois femmes au gouvernement de Léon Blum…
Une nouvelle génération d’auteurs et d’artistes s’impose à laquelle elle ne comprend rien : elle déteste Picasso et les cubistes, mais, plus généralement, tous ceux qui bousculent les conventions.
Petit à petit sa vie s’étiole. Elle s’est entichée d’une chanteuse plutôt vulgaire et sans charisme : Germaine de Castro. Elle lui consacre une grande partie de son temps, lui écrit des chansons l’accompagne au piano dans des petits récitals sans succès. L’argent fiche le camp. Elle doit vendre toutes ses propriétés, ses meubles. Elle finit sa vie tristement, dans la petite maison de Germaine à Château-Gontier où on lui a concédé à l’étage une chambrette et un cabinet de toilette. Elle qui a connu les propriétés fastueuses de son père, puis celles de son riche mari se retrouve à l’étroit, étriquée comme son univers qui se rétracte… Elle meurt d’une congestion pulmonaire le 29 avril 1945 à 70 ans.
Refermant cette biographie, il me reste l’image d’une femme brillante, mais peu sympathique. Frustrée de ne pas obtenir le succès qu’elle pensait mériter. Frustrée dans sa vie amoureuse. Incapable de remettre en cause les lourdeurs de son éducation très bourgeoise et finalement pleine d’amertume. Elle a tout de même marqué son temps par son impressionnante production littéraire.

Lucie Delarue-Mardrus, portrait à la cigarette 



Charles-Joseph Mardrus, son mari