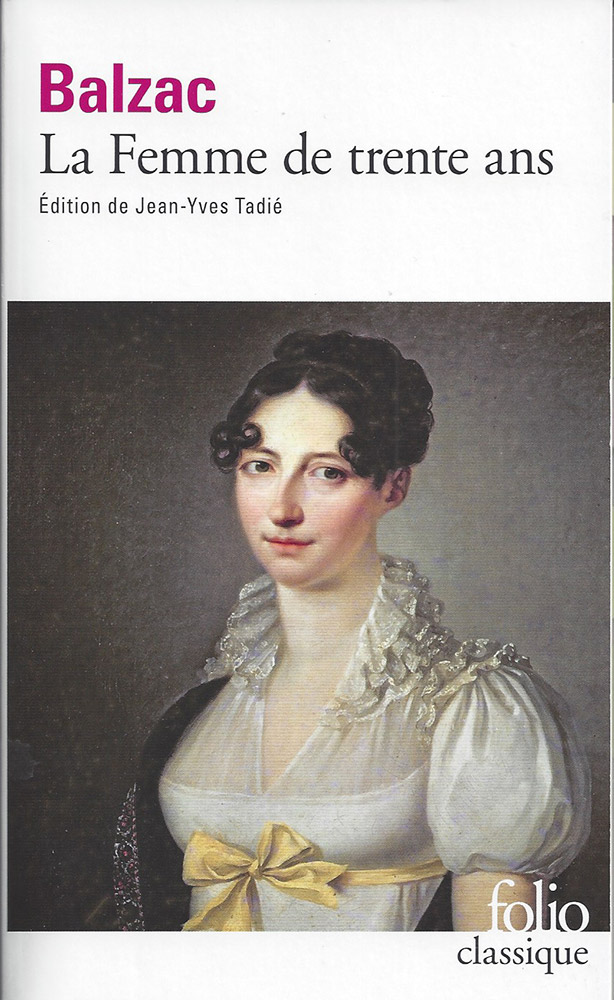La femme de trente ans
Balzac
Finalement, je me serais menti à moi-même en pensant que dans mes jeunes années j’avais lu des romans de Balzac. En vieillissant, on finit parfois par s’accorder un vernis qui n’existe pas ailleurs que dans votre imagination. Me croyant plus cultivé sur mes vieux jours qu’au temps de ma jeunesse j’ai tendance à m’inventer des lectures que je n’aurais jamais eues. Mais depuis le temps que je tourne autour de Balzac, j’ai sans doute l’impression de le connaître un peu.
Si j’ai vraiment beaucoup lu au cours de mon existence, j’avoue des lacunes à propos de certains grands auteurs : Balzac, Proust, Zola et c’est sans parler de Voltaire, Rousseau ou d’autres. J’ai consacré des heures à Maupassant, mais il m’a barbé. En revanche j’ai adoré Dickens, Jules Verne (et aussi Henri Verne auteur de Bob Morane) et, adolescent, j’ai fait une consommation effrénée de polars : OSS 117, San Antonio, Carter Brown et bien d’autres. Adulte j’ai varié mes lectures et, depuis quelque temps, je suis carrément devenu bouquivore.
Sachant qu’il n’est jamais trop tard pour arroser son coin de cerveau réservé aux grands classiques, je me promenai devant le rayon des poches l’autre jour à la lettre « B ». Et, le premier livre citant Balzac sur lequel je tombe est sa biographie écrite par Stefan Zweig. Lui, je l’adore. C’est un maître de la finesse psychologique. Dans ma tête, j’ai l’image d’un Balzac feuilletoniste, buveur de café, auteur de grandes sagas populaires. Une véritable machine à pondre des livres. Rien qui m’emballe a priori. Mais si Zweig lui consacre une étude, alors… J’achète l’ouvrage qui jouxte la bio : il s’agit de « La femme de trente ans ». Mes convictions féministes sont flattées par ce titre. 4,90 € plus tard il est dans ma poche.
En l’ouvrant, je ne tarde pas à comprendre que Balzac est entouré, suivi, analysé, décortiqué, observé, épluché, scruté par une bande de balzacophiles, balzacolâtres, universitaires ou non, qui se plaisent à pondre des préfaces, des postfaces et autres poulets soporifiques qui encadrent l’œuvre comme une tranche de jambon goûteux entre deux tranches de pain rassis. Je me méfie des préfaces et je ne les lis généralement qu’après avoir lu le livre.
Et force est de constater que « La femme de trente ans » n’est pas la meilleure entrée dans le monde de Balzac même si le thème en est intéressant. Au départ il s’agissait de cinq nouvelles qui ont été unifiées au fil du temps par l’auteur pour en faire un roman à part entière. Si l’histoire se tient (encore un peu de patience et je vous la raconte) le style varie entre peinture académique, essai philosophique et roman d’aventures. C’est un chouïa décousu mais avec de belles envolées.
Allez, je vous fais le pitch (vous n’êtes pas obligés de tout lire, parce que je vais gâchonner un peu beaucoup). La jeune et jolie Julie de Châtillon tombe éperdument amoureuse du marquis d’Aiglemont, superbe officier de cavalerie au service de l’Empereur. Elle décide de l’épouser contre les conseils de son père qui dit bien connaître la soldatesque et qui la prévient que derrière l’uniforme se cache souvent un rustre inculte. Elle n’en fait qu’à sa tête, son père clamse et la voilà marquise d’Aiglemont. La belle écervelée ne tarde pas à comprendre que son paternel avait vu juste. Si elle-même est fine, cultivée et sensible, son époux de mari la prend à la hussarde, n’a aucune conversation et ne s’intéresse pas à grand-chose. Déception, consternation, mais c’est trop tard, fallait y penser avant, ma petite. Cette expérience l’ayant refroidie la voilà si frigide avec le marquis que celui-ci ne tarde pas à aller chasser sur des terres plus accueillantes après toutefois lui avoir fait un enfant : sa fille Hélène. Julie accepte tout, la maternité et le cocufiage comme la punition de la faute qu’elle a commise en n’écoutant pas son père. Mais voilà qu’un bel Anglais, lord Arthur Grenville, repère cette beauté endormie et décide d’en faire la conquête. À force de persévérance, il finit par réchauffer le cœur de celle qui avait mis ses sentiments en berne. Mais soucieuse de morale et consciente de son devoir, elle se refuse longtemps à lui. Le soir où elle va finalement craquer, le mari rentre à l’improviste, l’amant qui n’en est pas un se planque sur le rebord de la fenêtre toute la nuit et (attention gros « spoil ») il crève des suites d’une mauvaise congestion pulmonaire.
Cette fois Julie est inconsolable. Un curé tente vainement de l’entraîner vers les voies du Seigneur pour la sortir de son spleen. Mais elle ne pense qu’à mourir, d’autant qu’elle n’a nullement la fibre maternelle et ne peut aimer d’un véritable amour la fille que lui a faite son crétin de mari.
Or donc, voilà qu’arrive le beau Charles de Vandenesse, jeune diplomate, revenu des séductions faciles et qui cherche une belle histoire pour donner un sens à sa vie. Il décide que Julie sera la femme de ses rêves. Mais elle ne cède pas facilement, s’abrite derrière les conventions, lui confie qu’après Arthur elle ne pourra jamais en aimer un autre. Cependant elle a trente ans, elle est belle comme un cœur, Charles sait se faire convaincant. Il insiste. Il persévère. Elle cède. Il lui fera un fils adultérin… qu’Hélène va tuer (volontairement ou non ?) lors d’un accident bizarre. Épisode que Balzac qualifie du « Doigt de Dieu ».
À partir de là, l’auteur saute allègrement les années, l’histoire s’accélère et s’emberlificote comme vous allez le voir. Julie se retrouve, toujours mariée avec plein d’enfants dont une fille, Moïna, qui est de Vandenesse et deux autres gosses dont ne sait trop s’ils sont du mari ou de l’amant. Un soir d’embrouilles, sa fille aînée, Hélène, se sauve avec un criminel et disparaît. Le marquis, dépité par la perte d’Hélène et qui a réalisé de mauvaises affaires part se refaire une santé financière dans les colonies laissant femme et enfant. Il revient quelques années plus tard, cousu d’or comme Tonton Cristobal. Pas de bol, son navire est attaqué par les pirates et il est dépouillé ! Mais, ô surprise, le chef des pirates n’est autre que le criminel et sa fille Hélène est devenue la cheftaine des affreux jojos. Elle rend les sous à son père, le fait déposer à terre et repart naviguer avec son beau corsaire.
Le marquis retrouve femme et enfants et meurt peu de temps après.
L’histoire se termine en quenouille. Julie passe des vacances avec les enfants qui lui restent dans une auberge du Pays basque. Elle entend pleurer dans la chambre d’à côté. C’est Hélène : son bateau a fait naufrage, son dernier enfant et seul rescapé meurt dans ses bras et elle-même rend l’âme dans les bras de sa mère. (Franchement, on n’y croit pas trop…)
Encore un saut dans le temps. Moïna a grandi. Elle a épousé un vieux barbon, le comte de Saint-Héreen et Julie apprend qu’elle a pris pour amant le fils de Charles de Vendenesse, un dandy sans scrupules, qu’il a eu par ailleurs. Autrement dit, elle couche avec son demi-frère : l’inceste est consommé. Pour garder un peu de suspense, je ne vous raconte pas comment meurt Julie, mais c’est… balzacien !
Que reste-t-il de cette lecture ? De longs passages ennuyeux de dissertation sur les états d’âme de la femme à vingt ans, trente ans, quarante et cinquante ans. On sent tout de même que Balzac a voulu démontrer que la femme devrait être libre d’aimer et d’être aimée. Qu’elle ne soit pas cantonnée au rôle d’épouse ou de mère, mais qu’elle puisse s’épanouir en tant que femme. Et ça, c’est bien.
(Oups, je m’aperçois que j’ai été presque aussi long et peut-être chiant que les Balzacasse-couilles que j’ai critiqués plus haut…)