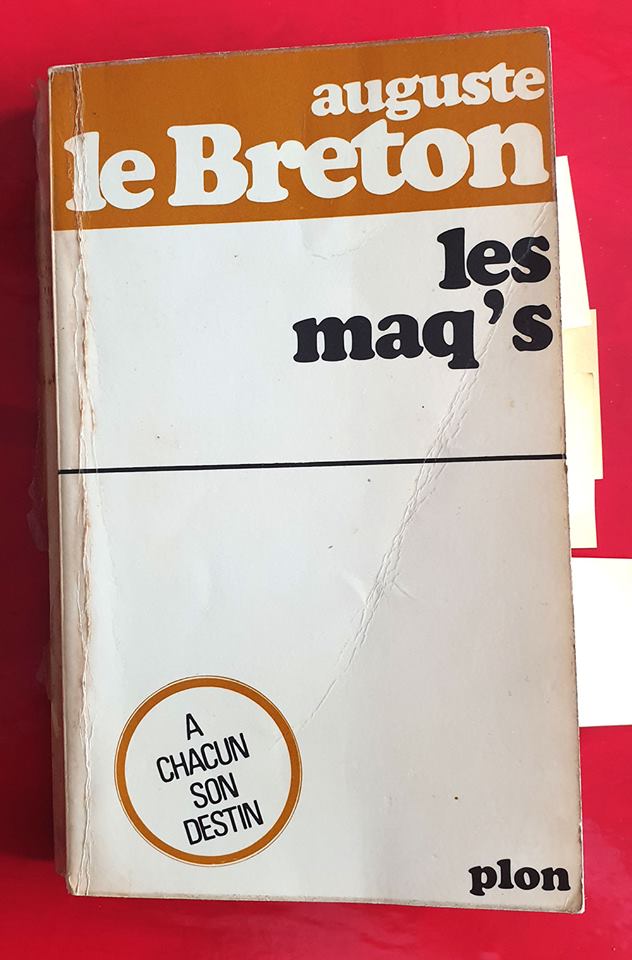Les Maq’s
Auguste Le Breton
Plon
Sous prétexte qu’ils respectaient un code de l’honneur et cherchaient parfois de la respectabilité, les maq’s (maquereaux, souteneurs, proxénètes) d’hier méritent-ils pour autant notre sympathie ? Certainement pas : truands ils étaient, truands ils restaient avec pour loi suprême la loi du plus fort physiquement et/ou mentalement. Séducteurs, baratineurs, enjôleurs puis brutaux et violents pour dompter leurs conquêtes avant de les mettre au tapin (sur « le ruban » de l’asphalte pour gagner leur « pain de fesse ») et qu’elles leur ramènent « la comptée ». Seul le rendement compte. On place les filles dans les bordels comme on joue de l’argent à la bourse en cherchant le meilleur taux de rentabilité.
Cependant, les temps ont changé et les mœurs aussi. Les jeunes truands d’aujourd’hui ont, semble-t-il, abandonné ce code d’honneur qui régissait le milieu et le semblant de courtoisie (si on peut appeler ça ainsi) qui organisait ce monde. Donc, et paradoxalement, en lisant les livres d’Auguste Le Breton, on en viendrait presque à se prendre d’affection pour ces personnages des années cinquante qui paraissent exercer un métier comme un autre. Sauf que leur matière première ce sont les femmes, ici traitées comme de la chair fraîche, taillables et corvéables à merci.
Mais alors où est le plaisir du lecteur ? Il est dans l’écriture. Car Auguste Le Breton n’a pas son pareil pour brosser des portraits et raconter des trajectoires de vie en allant droit au but, sans fioritures, sans états d’âme, mais avec le langage fleuri de l’argot. Pour illustrer mon propos, je vous propose cet extrait qui décrit la vie de Gina Beauclaire, femme du truand Jo Beauclaire et devenue mère maquerelle d’un lupanar de luxe à Paris. On y comprend comment elle a trouvé sa place dans ce réseau et aussi avec quelle joie vengeresse les filles encartées de l’époque se livraient aux travers de certains bourgeois dépravés. On sent que l’auteur est lui-même sorti des bas-fonds et qu’il n’est que tendresse pour ces déshéritées de la vie.
Extrait de « Les maq’s »
Le portrait de Gina Beauclaire, femme de maquereau et mère maquerelle.
Gina ne rigolait pas. Intransigeante elle se montrait sur la bonne tenue. Romaine de naissance, élevée dans la foi, de bonne famille, il avait fallu que quinze piges auparavant elle tombe sur Jo, en affaires à Rome. Pour lui, le baratineur, ç’avait été de la tartelette que d’emballer cette fille dont le corps avait faim. Et comme il était en fonds après son affaire, un lot de frangines fourguées à un riche bordel du cru, il l’avait trimballée partout, après l’avoir enlevée carrément à sa famille bourgeoise. Elle avait pas su résister, conquise par cet enlèvement de Roméo de trottoir. Pucelle elle était lorsqu’il l’avait passée à la casserole. Et quand le premier mâle est adroit de son guizot les nanas sont cuites, prêtes à tout pour conserver le citoyen qui leur a appris que les lardons poussent pas dans les choux. Tout le monde sait ça. Et Jo, sur l’oreiller, manquait pas de doigté. De retour à Paname, il l’avait collée au tapin rue Daunou. Mais ça n’avait pas gazé selon ses prévisions. Les Italiennes peuvent être merveilleuses au plumard, mais font rarement de bonnes putes. Il avait vite entravé, découvert qu’elle était de classe et qu’il lui fallait autre chose. Et lorsqu’une affaire de meurtre l’avait obligé à filer en Argentine, il l’avait fait venir et lui avait donné des maisons d’illusions à driver. Là elle s’était avérée imbattable. Encaisser la fraîche, gourmander les femmes, avec son allure de duchesse, semblait son élément. Jo avait compris où était sa vraie place, et depuis leur retour en France après bien des aléas, il avait réussi à attriquer un hôtel particulier rue de Monceau, camouflé au fond d’un jardin, et que Gina avait transformé rapidement en l’une des plus belles maisons à caresses de France. La baraque était tout ce qu’il y avait de discret avec double sortie et où les michetons étaient traités en seigneurs. Arts, finance, industrie et politique fréquentaient chez Gina. Ces dames turbinaient en robe de ville très stricte, le champ’ était de première et les gros mots exclus. Du moins dans les salons où s’échangeaient les courbettes et où s’amorçaient les parties de jambes en l’air. Dans les carrées, c’était une autre paire de manche, vu que certains clilles aimaient se faire couvrir d’insultes. Leur droit le plus net. Et lorsqu’ils avaient envie de se faire ficeler sur la croix de Saint-André plantée dans une piaule décorée en style funéraire avec chandeliers d’argent, encens, tentures de mort et le toutim, et qu’ils imploraient qu’on leur cingle la couenne à coups de fouet, ils obtenaient satisfaction. Ô combien ! Les putes s’en payaient du bonheur à manier martinets, cravaches, ceintures de cuir ! À croire qu’elles se vengeaient de leur condition et des sagouins qui leur demandaient ce qu’ils n’osaient pas demander à leur légitime. Là, elles la tenaient leur revanche. À genoux, suppliants, vils et ignobles, elles se les offraient les puissants : gros manitous, grands chefs, banquiers rutilants, procureurs, avocats généraux, diplomates, tous ceux qui condamnent, punissent, requièrent, tranchent, décident, décrètent, exigent, agitent les lois, l’anathème, le fanion justicier ou guerrier, ceux qui poursuivent les faibles, les perdus d’avance, leur font courber l’échine, s’incliner, mordre la poussière, poussière de ciment, de charbon, ou de cimetière. Au bout de leurs mains fragiles aux ongles peints, c’était comme si les radeuses qui frappaient les chairs flasques, brandissaient les taudis de leur enfance, les ruelles sans bec de gaz et les bouges où souvent on les avait violées, les orphelinats et les centres d’éducation surveillée où on les avait enfermées, leurs pères alcooliques, leurs mères toujours engrossées et bêtes à chialer et tous les exploités, les sous-alimentés avec lesquels elles avaient vécu. Tout ce qu’ils désiraient, ils l’obtenaient les rupins. Gina y veillait. Tout leur était accordé, permis. Et lorsque les plus fondus suppliaient qu’on leur lansquine ou leur tartisse sur le museau, les nanas satisfaisaient. Bien sûr, le plus duraille était pour elles d’avoir envie en ces moments cruciaux ! Mais en se forçant un chouïa… en sachant que l’avilissement des puissants serait plus complet… Et c’était parce que Gina connaissait trop bien la pourriture des hommes qu’elle tenait à préserver ses enfants des saletés de l’existence. De là son intransigeance sur l’éducation de ses filles. Son but était plus tard, lorsqu’elles seraient en âge, de les emmener à Rome et de les maridas avec des notables, pauvres ou non. Ainsi que toutes celles qui vivent du pain de fesse, elle aspirait à la respectabilité. Pour elle, ce ne serait qu’un retour aux sources bourgeoises de son adolescence. Jo était pas contre, loin de là. L’un des premiers il avait émergé des bas-fonds pour planter sa tente dans les quartiers rupins. Dans le mitan encore pas évolué, sauf les gros bordeliers et les voyageurs, on le charriait d’avoir osé. Mais on l’enviait aussi.