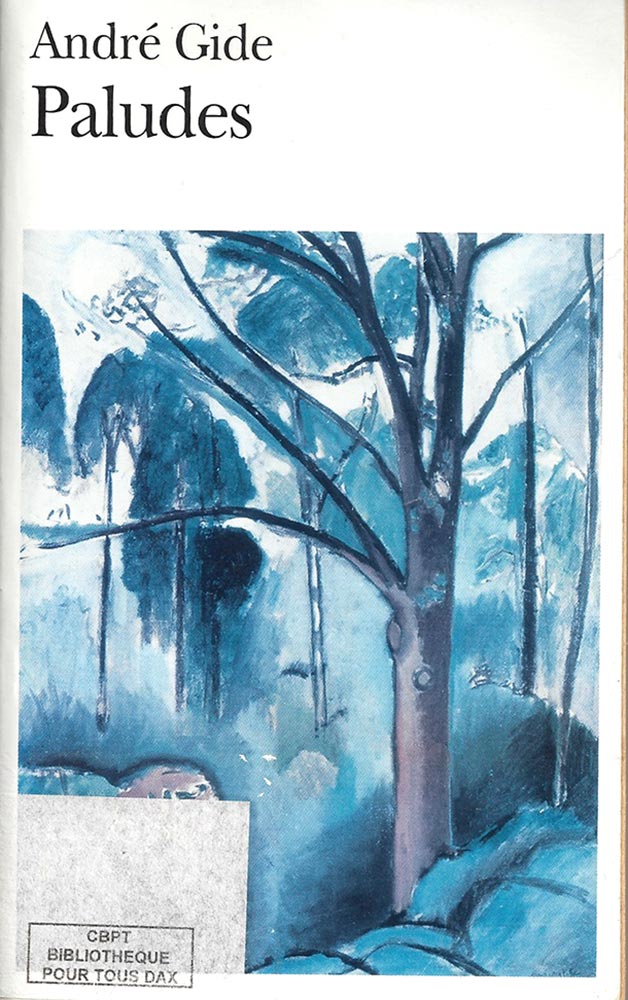Paludes
André Gide
Je viens de lire mon second (et donc il n’y aura pas de troisième) livre d’André Gide : Paludes. Il a, à mes yeux, pour seul mérite d’être court : environ 150 pages. Si je ne l’apprécie pas, c’est que je suis totalement étranger à cet univers de la poésie/philosophie en prose dont Maurice Barrès fut un des instigateurs les plus pédants. C’est, à mon goût personnel, prodigieusement ennuyeux, souvent vaniteux et terriblement suffisant.
« Palude » signifie « ce qui a trait au marais ». Gide s’inspire d’un personnage de Virgile, Tityre, esclave affranchi, mais pauvre et sans moyens. Il en fait un paysan vivant dans une tour, au milieu d’un marigot et qui se contente de ce qu’il a. Il s’interroge sur cet état de fait. Il constate que le genre humain en général ne fait pas d’effort pour sortir de sa fange et trouve tous les prétextes pour s’en satisfaire. Il mène un combat intérieur ardent contre cette capitulation. Mais dans son quotidien, le même combat est mou et apathique.
Afin de développer cet argument, Gide recourt à un procédé d’écriture. Son livre est construit comme le journal d’André Gide en train d’écrire Paludes. Il mélange donc la vie de l’auteur, ses réveils difficiles, ses pensées intimes pas toujours reluisantes, ses relations avec des amis proches (dont on se demande s’ils existent ou s’ils sont inventés), le tout entrecoupé de fragments censés constituer Paludes.
En réalité, c’est ce marécage littéraire, ce mélange de journal, de bouts de textes, de comptes-rendus de conversations qui forme Paludes. On ne sait pas où va l’auteur, lui non plus, c’est d’ailleurs ce qui lui plaît. Fatras de souillarde, d’arrière-cuisine d’écrivain ou géniale églogue (poème pastoral) d’un latiniste inspiré ? Pour moi, c’est du dilettantisme de dandy qui veut se distinguer du vulgum pecus. Ce n’est pas mon monde, mais je ne lui en veux pas d’exister.
Va, je ne te hais point. (Final et terminal).