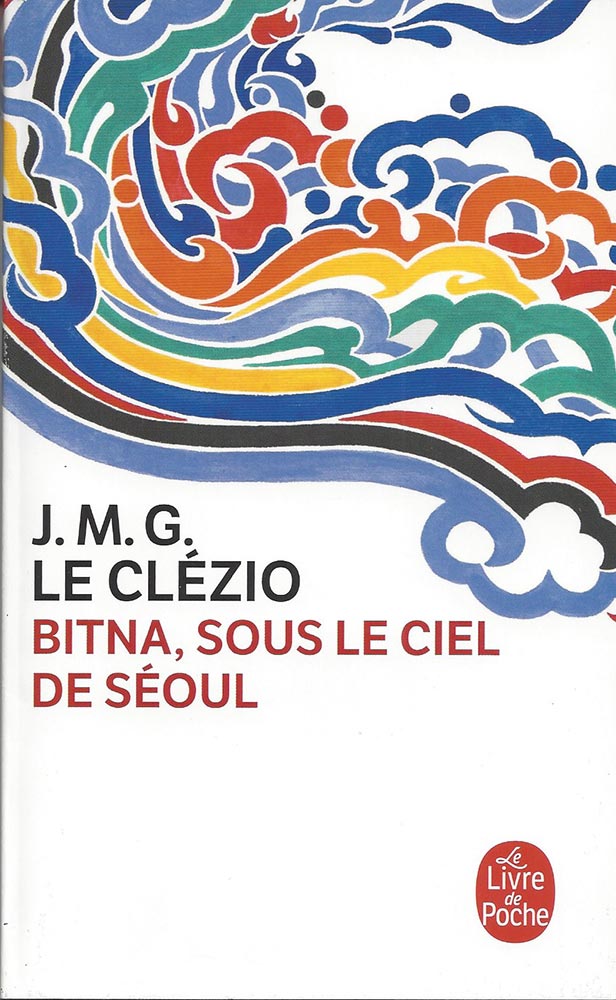Bitna sous le ciel de Séoul
J.M.G. Le Clézio
C’était au début des années soixante-dix. Je n’avais pas encore dix-huit ans et j’avais atterri par miracle en Hypokhâgne au Lycée Victor Hugo, rue de Sévigné. Lycée de jeunes filles dont seule la classe d’hypokhâgne s’était ouverte aux garçons. Nous étions deux, cernés par l’autre sexe et j’ai adoré ça. J’ai oublié l’autre : il était filigrane.
Officiait en ces lieux une professeure de philo d’une trentaine d’années, du nom de Béatrice Josipowicz dont j’étais immédiatement tombé amoureux. Elle m’avait pourtant sacqué et ma première dissertation s’était vue gratifier d’un « 2 ». Je décidai dès lors de ne plus travailler, mais d’entreprendre la conquête de ladite professeure. Folie d’adolescent. Elle accepta d’abord des discussions enflammées dans les cafés du quartier Saint-Paul puis m’invita à dîner chez elle en compagnie de ses amis et, ensuite seul. Rue Hyppolite Maindron. J’étais l’unique élève de la classe à bénéficier de ce régime de faveur. Elle aimait mes mains, parler avec moi, mon idéalisme incandescent. J’aimais le léger pli qui barrait son cou gracile à l’endroit où nous autres, garçons, voyons s’activer notre pomme d’Adam. Elle me trouvait intelligent et différent, me prédisait un avenir dans les idées, je la trouvais belle et géniale. Les mots s’enchaînaient. Elle pleura près de moi lorsqu’une de ses amies mourut du cancer du sein. Nous avons dormi l’un près de l’autre sans consommer, car elle était finalement bien raisonnable et moi aussi timide en actes qu’audacieux dans les phrases. Peu après, elle rencontra un garçon de sa génération qui la tira de la métaphysique où s’emmêlaient nos chastes relations. Il sut l’emmener danser dans une boîte de jazz et conquit son corps.
Béatrice me parlait souvent de Le Clézio. Ils avaient fait études communes à la fac de lettres de Nice. Elle admirait son talent et me conseilla la lecture du « Procès Verbal » qui avait décroché le prix Renaudot quelques années auparavant.
Je me jetai avec avidité dans ce roman énigmatique et symbolique à souhait. Adam Pollo, le héros, fuit la civilisation et se retire dans une villa méditerranéenne où sa schizophrénie se développe peu à peu. Entre philosophie et folie, il finit à l’asile. Rejet du monde, de ses codes, Le Clézio marquait ses premiers pas dans la critique d’une société trop normalisée.
Plus tard, en vacances sur la Côte d’Azur, je lisais « Les Géants », dénonciation acerbe des hypermarchés, symboles de l’aliénation consommatrice (« il faut brûler Hyperpolis » disait l’auteur).
Je quittai enfin Victor Hugo, Béatrice et Le Clézio pour partir vers d’autres cieux, d’autres femmes.
Pendant des années, je n’ai plus ouvert un livre de cet auteur. C’était comme un tabou. Le Clézio et Béatrice ne faisaient qu’une entité. Ayant perdu l’une j’avais perdu l’autre.
Elle est morte voilà de cela quelques années. Je l’ai appris par une relation de ma mère dont elle était l’amie. Elle avait lutté contre le diabète qui avait eu raison d’elle. De son passé, j’ai tout oublié où je n’ai pas voulu me souvenir. Mais son visage, son cou, son regard étonné sont à jamais gravés dans ma mémoire.
Et puis ce court roman de Le Clézio m’est passé sous le nez. Je cherchais lecture en magasin. Il m’a tendu la main. La prescription était levée, je l’ai emporté.
Que dire de « Bitna, sous le ciel de Séoul » ? Les démons de Le Clézio se sont assagis, mais ils sont toujours présents. Bitna, jeune étudiante coréenne issue d’un milieu pauvre est embauchée par Salomé, jeune femme riche et seule, atteinte d’un mal incurable, pour lui raconter des histoires. Bitna invente, mêle fiction et réalité, réalisme et poésie. Elle prend conscience du pouvoir que ses mots de pauvre lui donnent sur la malade. En abuse-t-elle ? Le récit est moyen, le style sans élégance. Béatrice n’est plus et l’ombre de Le Clézio a pâli sur le mur de mon souvenir. Son prix Nobel de 2008 n’y change pas grand-chose à mes yeux. Peut-être a-t-il été un génie entre les années soixante-dix et aujourd’hui ? Dans le fond, je n’ai plus envie de le savoir. Cette idole littéraire ne pouvait, pour moi, marcher que sur deux pieds. Ayant perdu l’un, je l’ai retrouvée boiteuse.