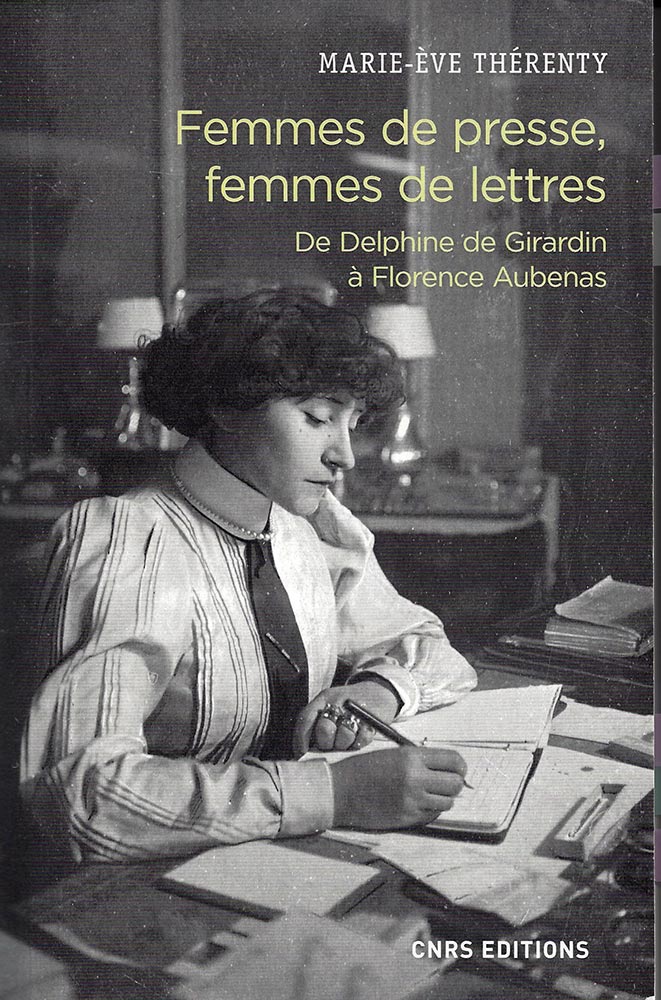Femmes de
presse, femmes de lettres
Deuxième chapitre : les publicistes ou les Cassandre
Troisième
chapitre : Les Frondeuses ou les Bradamante
Marie-Ève Thérenty
Éditions du CNRS
Finalement, j’ai bien fait de m’accrocher, car ce livre est une véritable mine d’informations sur les femmes journalistes. Mais la densité d’écriture m’oblige à en rendre compte chapitre par chapitre (il n’y en a que six…). Voici donc la présentation des 2e et 3e chapitres.
Deuxième chapitre : les publicistes ou les Cassandre
Chaque chapitre s’articule de la façon suivante : la mise en avant d’une personnalité phare, l’analyse de son œuvre et de sa vie, puis suit une ribambelle d’autres personnages qui ont œuvré dans la même lignée que cette « première de cordée » (pour reprendre une expression chère à qui vous savez).
Le texte sur les « chroniqueuses » s’intéressait aux femmes qui ont pénétré la sphère du journalisme par le biais de la rubrique des potins, de la critique (littéraire, théâtrale) ou de la mode, mais qui s’abstenaient ouvertement de parler de politique (ou alors à mots couverts). Avec les « publicistes », on franchit une étape et Marie-Ève Thérenty nous présente celles qui « parlent explicitement politique dans le journal ». On notera que ces deux styles de journalisme ont pu cohabiter à la même époque et ne se sont pas forcément suivis chronologiquement.
Elle a choisi George Sand comme représentante du genre. En plus de sa production romanesque, Sand a inondé la presse de ses articles. Elle a écrit, nous dit l’auteure, dans les quotidiens, les grandes revues, les magazines, les illustrés, les petits journaux littéraires. Elle a pratiqué la critique sous toutes ses formes (littéraire, picturale, musicale…), les grands articles politiques, le récit de voyage, les études de mœurs, les nécrologies, le billet d’humeur, le droit de réponse… Dès son arrivée à Paris elle travaille pour le Figaro, puis elle signe un contrat avec la Revue des deux mondes. George Sand était noble par son père, mais roturière par sa mère. Et, de par cette seconde origine, elle a toujours été sensible aux problèmes de société et elle a développé une fibre sociale, pour ne pas dire « socialiste » dans ses écrits et ses articles. Elle mène aussi une vie très libre, collectionnant les amants, fumant et s’habillant comme un homme. Ce faisant, elle prête le flanc aux critiques les plus machistes et les plus violentes. Elle n’en a cure. De plus, elle est insensible aux mouvements féministes et refuse de se présenter à la députation quand les féministes le lui demandent : « Je ne puis me permettre que, sans mon aveu, on me prenne pour l’enseigne d’un cénacle féminin avec lequel je n’ai jamais eu la moindre relation agréable ou fâcheuse ». Elle en défend pourtant certaines causes, comme celle du divorce (qui l’intéresse au plus haut chef…) ou de l’égalité salariale. Sans complexe, elle se bat pour être bien payée. Quittant le Figaro pour la Revue des deux mondes, elle écrit au directeur : « Je vous avertis que j’aurai la prétention d’être mieux payée… »
Marie d’Agoult (1805-1876) qui signe sous le pseudonyme de Daniel Stern est dans un premier temps l’amie de George Sand, puis sa plus féroce concurrente. Son pseudo « Stern » qui signifie « étoile » en allemand vient en opposition à « Sand » qui veut dire « sable » en anglais. Sous son nom de plume masculin, elle écrit des articles « virils », sans complaisance envers les femmes écrivaines ou artistes. Elle publie aussi des articles très politiques et pressent la Révolution de 1848 (d’où son classement parmi les « Cassandre ») dont elle rendra ensuite compte avec talent.
Juliette Adam (1836-1936) fait également partie de ces femmes journalistes qui s’engagent en politique. J’ai déjà eu l’occasion d’écrire un article sur ses idées anti-proudhoniennes (https://jeanlouislebreton.com/?p=1826).
Deux autres personnalités sont encore mises en valeur dans ce chapitre consacré aux femmes journalistes parlant de politique : Claude Vignon (1832-1888), de son vrai nom Marie-Noémie Cadiot, libre-penseuse et un temps militante féministe avant de s’éloigner du mouvement, et Geneviève Tabouis (1892-1985), grande analyste politique qui fit sa carrière dans la presse écrite, mais surtout à la radio.
Troisième chapitre : Les Frondeuses ou les Bradamante
Bradamante est un personnage de fiction de la littérature italienne, une chevalière qui combat avec une lance magique qui désarçonne tous ceux qu’elle atteint. Belle image pour parler de ces amazones du journalisme.
C’est, jusqu’à présent le chapitre qui m’intéresse le plus. En disant dans sa préface qu’elle s’intéresserait peu aux féministes*, Marie-Ève Thérenty nous a induits en erreur. En effet ce chapitre est principalement consacré au journal La Fronde et aux « frondeuses », ces journalistes qui, à la différence des publicistes écrivant depuis leur bureau, n’hésitaient pas à se déplacer pour vivre l’événement et en rendre compte.
Alors certes, les collaboratrices de La Fronde n’étaient pas toutes des féministes « pures et dures », mais la plupart des féministes pures et dures ont écrit dans La Fronde (à commencer par mon arrière-grand-mère, Maria Vérone, qui est évoquée plusieurs fois dans ce texte).
C’est Séverine (1855-1929) qui sert de « personnalité phare » à ce chapitre. Et, franchement, c’est mérité. Parce qu’elle a révolutionné le genre journalistique féminin. Née Caroline Rémy, elle épouse à seize ans et demi (pour ficher le camp de chez elle) un certain Henry Montrobert, employé du gaz, qui la « viole légalement » le soir de ses noces. À dix-huit ans, elle obtient la séparation de corps et de biens (et le divorce quelques années plus tard). Elle devient la maîtresse d’Adrien Guébhard, riche docteur en médecine et agrégé de physique qui la met enceinte. Elle accouche en Belgique où elle rencontre en 1879 Jules Vallès, communard exilé qui la forme à l’écriture et au reportage journalistique. Avec lui, et grâce à l’argent de Guébhard, elle relance Le Cri du Peuple en 1883, journal socialiste et militant. Elle en assume la direction avec Jules Vallès, puis seule à la mort de celui-ci en 1885. Des conflits idéologiques l’opposent à certains membres de la rédaction, en particulier avec Jules Guesdes (qui ne supporte pas d’être dirigé par une femme). Sa liaison avec le journaliste Georges de Labruyère fait scandale, d’autant qu’elle place Adrien Guébhard, le généreux donateur, dans le rôle du « cocu magnifique »… En 1888, Séverine jette l’éponge et quitte le journal.
Elle va alors travailler en indépendante, écrivant dans de multiples titres, même opposés à ses valeurs, tant qu’on ne la censure pas et qu’elle reste libre de dire ce qu’elle veut. Elle impose ses conditions sans rien abdiquer de son caractère.
Elle sort et n’hésite pas à prendre des risques même pour sa santé : descendre dans les mines après le coup de grisou (gazée, elle sera hospitalisée), se mêler aux ouvrières casseuses de sucre qui sont en grève… C’est une risque-tout.
En 1897, Marguerite Durand lance La Fronde, premier quotidien entièrement rédigé et géré par des femmes. Séverine en est la vedette. Son tirage atteint 50 000 exemplaires quotidiens en 1898. Marguerite Durand a de l’argent, acquis par son travail de comédienne (elle est issue de la Comédie française), par son mariage avec le député (de gauche) Georges Laguerre (ils divorcent en 1895) et par le quotidien boulangiste qu’ils ont créé ensemble : La Presse. En réalité, d’autres fonds ont été nécessaires pour lancer La Fronde, mais on ne sait pas comment elle s’est débrouillée pour les obtenir.
Le journal est constitué de femmes de premier plan (Séverine, Jeanne Brémontier, Louise Michel) et d’autres qui ne sont pas issues du sérail comme Sandrine Lévèque, Camille Bélilon ou Maria Vérone (mon arrière-grand-mère qui occupe la rubrique judiciaire sous le pseudo de « Thémis »).
Marguerite Durand doit faire face à une kyrielle de problèmes, en particulier le fait qu’on interdise aux femmes de travailler la nuit. Or, c’est toujours la nuit que le journal se boucle. Elle parvient à contourner cette interdiction en créant la « Société coopérative des femmes typographes ». Plus tard, elle ira même jusqu’à fonder une maison de retraite pour les femmes journalistes.
La Fronde est un tremplin pour de nombreuses jeunes femmes qui essaimeront dans diverses rédactions. Pour Maria Vérone, c’est la porte ouverte vers des études de droit qui la mèneront à devenir avocate (la première à plaider en cour d’assises), mais aussi à prendre la rédaction en chef du magazine de la LFDF (Ligue Française pour le Droit des Femmes).
Dans la rédaction de La Fronde, on compte des féministes militantes : Hubertine Auclerc, Camille Belilon (militante en faveur de l’avortement), Marguerite Belmant (fondatrice de « L’union fraternelle des femmes »), Maximilienne Biais (créatrice d’un comité féministe au sein de la CGT en 1907), Marie Bonnevial (présidente de la LFDF en 1904), Paule Minck et Louise Michel (anciennes communardes), Cécile Brunschvicg (une des trois premières femmes à être nommées « ministres » dans le gouvernement de Léon Blum) et d’autres…
On le voit, La Fronde a été une véritable pépinière. Et elle a permis à toutes ces femmes de gagner leur vie. Séverine est payée 150 francs par article. Les autres reçoivent jusqu’à 300 francs par mois (à titre de comparaison, le salaire d’une institutrice était d’environ 90 francs par mois).
Avec l’affaire Dreyfus, La Fronde augmente ses tirages et prend position en faveur de Dreyfus. Elle va même jusqu’à reproduire l’article « J’accuse » de Zola, sans en demander la permission. Séverine, Marguerite Durand et Jeanne Brémontier sont trois des sept femmes journalistes qui assistent au second procès de Dreyfus à Rennes…
À partir de 1905, les ventes diminuent puis s’effondrent. La Fronde passe au rythme mensuel avant de disparaître complètement.
Puis arrive la Grande Guerre et, là encore, des journalistes n’hésitent pas à monter au front. Séverine, toujours elle, mais aussi Colette qui, à cette époque, s’est remariée avec Henry de Jouvenel, rédacteur en chef du Matin. Jouvenel est mobilisé. Colette, bravant les interdits, le rejoint sur le front et signe quelques retentissants reportages de guerre. Tout comme son amie Annie de Pène qui écrit aussi pour Le Matin et pourl’Œuvre… Annie de Pène mourra de la grippe espagnole le 14 octobre 1918 à 47 ans. Sa fille, Germaine de Beaumont, reprendra le flambeau du journalisme (au Matin et aux Nouvelles Littéraires) et sera la première femme à obtenir le prix Renaudot pour son roman « Piège » en 1930.
On le voit, la période d’avant-guerre a été particulièrement féconde pour je journalisme féminin (et féministe) qui a fait son entrée dans la grande cour des médias et de la meilleure manière.
* J’ai fini par comprendre qu’elle ne s’intéresserait pas aux « petites » publications des féministes et qu’elle voulait rester dans le cadre de la grande presse généraliste (ce qui est le cas de La Fronde), mais qu’elle n’avait rien contre les féministes. Je me suis énervé un peu vite, mais sa préface n’était pas claire.

George Sand 
Marie D’Agoult 
Juliette Adam 
Séverine 
Marguerite Durand 
Maria Vérone 
Marie Bonnevial 
Louise Michel 
Hubertine Auclert 
Geneviève Tabouis 
Colette 
Cécile Brunschvicg 
Annie de Pène 
Germaine Beaumont